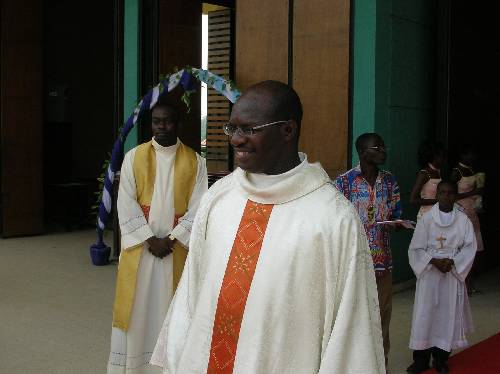Les Divisions dans l'Eglise: Origines
Les origines des
divisions dans l’Eglise
Après l’Ascension de Jésus, les disciples restent un
temps soit peu inactifs jusqu’au jour où l’Esprit Saint se manifeste à eux lors
de la pentecôte juive. Libérés de la peur et remplis de la force de l’Esprit de
Dieu, ils vont pour la première fois à la rencontre du peuple pour l’annonce
kérygmatique, c’est-à-dire proclamer à tous que ce Jésus qui a été crucifié,
Dieu l’a ressuscité des morts conformément aux Ecritures, qu’il est Seigneur et
qu’eux en sont des témoins vivants (Ac 2,14-41).
C’est la première profession de foi publique. Le Credo que nous récitons aujourd’hui dans nos assemblées eucharistiques trouve sa source dans cette proclamation apostolique des origines.
A la suite de
cet évènement de la pentecôte qui a vu le baptême d’environ trois mille âmes
(Ac 2, 37-41), est né la première communauté des croyants en Jésus Christ (Ac
2, 42-47). Cette communauté avait déjà en son sein les premiers jalons de toute
communauté chrétienne qui naîtra par la suite : « ils se montraient
assidus à l’enseignement des Apôtres, fidèles à la communion fraternelles, à la
fraction du pain et aux prières ; ils mettaient tout en commun. Et chaque
jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés »
(Ac 2,42.44.47). Mais très vite, cette première communauté va se disloquer à la
faveur des persécutions subies par les chrétiens. C’est le moyen par lequel
l’Esprit Saint suscitera l’expansion de l’Evangile à travers toute
L’expansion de
l’Evangile crée de facto la naissance de nouvelles communautés chrétiennes.
Cependant la vie à l’intérieure de ces communautés ne sera pas sans
achoppement. C’est ainsi que ces communautés vont vivre en leur sein des crises
de tous ordres. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens suffit pour
étayer amplement les divisions qui ont surgi au début du christianisme. Par
ailleurs, l’histoire de l’Eglise nous révèle également que la vie de l’Eglise a
été marquée par de graves divisions entre autres le schisme d’Orient, le
schisme d’Occident et la réforme protestante. Toutes ces divisions sont
motivées par deux causes majeurs : le problème d’autorité (leadership) et
le problème doctrinal.
I- Les divisions dans les premières communautés
chrétiennes, l’exemple de Corinthe
Dans sa première lettre aux Corinthiens, Saint Paul adresse à ses lecteurs cette exhortation : « Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus Christ : soyez tous d’accord, et qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous ; En effet, mes frères, les gens de Chloé m’ont appris qu’il y a des discordes parmi vous » (I Co 1,11). C’est dire que la lutte contre les divisions a de tout temps animé l’action des pasteurs dans la mesure où ceux-ci ont la charge de maintenir la flamme de l’unité comme l’a voulu le Christ : « Que tous soient un » (Jn 17,21). Dans cette communauté de Corinthiens, il a existé des divisions d’ordre culturel, moral et doctrinal.
Il s’est posé le problème de leadership : « chacun de vous parle ainsi : « Moi, j’appartiens à Paul. –Moi à Apollos. – Moi à Céphas. – Moi à Christ. » (I Co 1,12). Et Paul de s’interroger « Le Christ est-il divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? »
Il a existé le débat sur la vraie et la fausse sagesse. En effet, il était à peu près inévitable que, vivant dans le monde religieux hellénistique, les chrétiens soient tentés de penser leur foi sur le modèle des nombreux cercles d’initiation qui groupaient les disciples d’un maître renommé. D’où l’engouement pour des prédicateurs comme Apollos qui devait avoir le brillant et l’éloquence de ces maîtres païens ; d’où aussi les divisions, chacun voulant se mettre sous le patronage d’un chef d’école. La réaction de Paul est vive. Il s’oppose énergiquement à cet état de choses car il y voit le danger d’une réduction de la foi chrétienne à une sagesse philosophique humaine ; il constate les rivalités d’écoles qui en sont les conséquences et qui ruinent sa conception de l’Eglise-rassemblement. Paul va donc opposer la sagesse humaine à la « folie » de la prédication (I Co 1,17-25) afin que la foi des chrétiens ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu (I Co 2,5).
Les désordres
dans les assemblées religieuses (chap 11-14) constituent un nouveau cas de
contamination de la vie chrétienne par les comportements issus de la mentalité
religieuse du paganisme. Que ce soit les abus dans la célébration de
l’Eucharistie où l’ambiance suspecte des repas sacrés du paganisme semble
s’être déjà infiltré (I Co 11,21), que ce soit l’atmosphère des réunions
liturgiques où l’on retrouve également des éléments de l’exaltation quelque peu
délirante de certaines réunions religieuses que les chrétiens fréquentaient
sans doute avant leur conversion, le but de Paul est toujours le même :
maintenir le caractère propre du culte chrétien qui n’a pas à se conformer aux
mœurs religieuses environnantes mais doit refléter le mystère célébré :
l’unité de la communauté dans le Christ.
Au plan
doctrinal, Nous assisterons à l’apparition des hérésies de toutes sortes.
Autant dire
que les divisions ont toujours miné la bonne marche de l’Eglise. Au cours de
son histoire, l’Eglise va connaître de profonds déchirements tels que les
schismes.
II-
Les différents schismes et la réforme protestante.
L’Eglise a
connu deux grands schismes : le schisme d’Orient (IXè-XIè siècle) et le
schisme d’Occident (XIVè-XVè siècle). Avec la réforme protestante, nous
assisterons désormais à la floraison d’une multitude de communautés chrétiennes
indépendantes se réclamant du courant luthérien.
1)
Le schisme d’Orient (IXè-XIè s)
Il s’agit de la rupture qui est intervenue entre l’Eglise d’Orient et l’Eglise de l’Occident. Cette séparation est le résultat d’un dialogue absolument manqué entre le Patriarche de Constantinople, Michel Cérulaire et le pape Léon IX (par son légat, le cardinal Humbert). Le motif immédiat est à la fois juridique, liturgique et politique. Il aboutit à la rupture et à la mutuelle excommunication (1054). Derrière ces raisons il y a des oppositions plus anciennes et profondes. Elles portent en partie sur deux conceptions de l’Eglise : plus collégiale en Orient, plus monarchique en Occident. Elles concernent aussi la théologie trinitaire : l’Eglise, enracinée dans le mystère trinitaire, valorise l’Esprit en Orient et le Christ en Occident. D’une conception de l’Eglise plus juridique en Occident, plus mystique en Orient.
La cause la plus importante de la rupture entre Rome et Constantinople se trouve sans doute dans l’intensification du centralisme papal et dans les prétentions des Evêques de Constantinople. En effet, imposant de façon autoritaire ses coutumes, l’Eglise de Rome ne respectait pas toujours les « antiques privilèges » des Eglises orientales, les premières de l’histoire. D’autre part, les Evêques de la ‘Nouvelle Rome’ (Constantinople) avaient tendance à se considérer comme la suprême autorité doctrinale et disciplinaire de l’Orient sur un pied d’égalité avec l’Evêque de Rome, considéré comme l’autorité suprême de l’Occident seulement.
Le 5 juin
1305, Bernard GOT, archevêque de Bordeaux est élu pape sous le nom de Clément
V. Son couronnement initialement fixé à Vienne, eut finalement lieu à Lyon. Et
dès 1309, le pape se fixe à Avignon. Pendant soixante-dix ans (70), les papes
résideront à Avignon en raison de l’insécurité de Rome et de l’Italie, mais
aussi à cause de l’influence politique de
Après la mort de Grégoire XI, seize (16) cardinaux entrent en conclave et élisent comme pape l’archevêque de Bari, Bartolomeo Prignano, un napolitain qui prend le nom de Urbain VI (18 avril 1378). Mais dès la fin du mois d’avril, Urbain VI s’attirait l’hostilité des cardinaux en leur reprochant en public et avec violence leur luxe et leur absentéisme, allant jusqu’à les traiter de voleurs. Et voulant même réduire brusquement leur train de vie.
Sous des prétextes divers, les cardinaux s’éloignent, un à un de Rome. Ils contestent l’élection d’Urbain VI. Le 20 septembre, ils entrent en conclave et élisent Robert de Genève qui prend le nom de Clément VII. La chrétienté se divise donc en deux obédiences. Ainsi commence le schisme d’Occident qui devait durer trente et neuf (39) ans. Cette situation finit par nuire à l’Eglise. A Urbain VI, pape de Rome succédèrent Boniface IX, Innocent VII, Grégoire XII. A Avignon, Benoît XII succéda à Clément VII.
Le concile de
Pise en 1409 fut d’accord de déposer les deux papes considérés comme
destructeurs de l’Eglise. On élit l’archevêque de Milan qui prit le nom
d’Alexandre V. le résultat est la présence simultanée de trois (3) papes. Le
concile de Constance en 1414 convoqué par Jean XXIII puis abandonné par lui,
acceptera l’abdication de Grégoire XII. Benoît XIII réfugié en Espagne sera
déposé, abandonné par les Espagnols qui reconnaissait son autorité. Son
successeur Clément VIII est rejeté par tous. Le 11 novembre 1417, les cardinaux
élisent comme pape Oldone Colonna sous le nom de Martin V. le grand schisme
d’Occident prenait ainsi fin.
3)
La réforme protestante.
La réforme luthérienne qui est une véritable révolution, s’est édifiée sur un arrière fond de raisons extrêmement mêlées qu’on ne peut jamais séparer sans risquer de tronquer la réalité. Les abus et les tares de Rome, les ambitions politiques de l’Allemagne et la crise économique qui frappe alors l’Europe sont quelques unes de ces raisons. Mais elles ne suffisent à tout expliquer. Aussi faut-il d’abord chercher les sources de cette rupture dans la personne même de l’initiateur de la réforme : le moine augustinien, Martin Luther.
Né le 10
novembre 1483, Martin LUTHER va connaître une enfance paisible jusqu’au jour où
il a été surpris par un orage dans un bois et que la foudre est tombé à ses
pieds. Affolé, il fait à
L’expérience
dont il s’agit se situe dans les années 1512-1513, pendant la préparation d’un
cours d’exégèse biblique. Selon la description que Luther lui-même en a fait,
tout se passe comme s’il était tout à coup éclairé par une lumière divine qui
dissipe toutes ses inquiétudes et apaise son cœur. Grâce à l’Ecriture qui
devient dès lors le foyer unique de son activité doctrinal, il résout le
paradoxe qui tenaillait son esprit : « comment le Dieu miséricordieux
peut-il être en même temps juste ? » Il trouve la réponse dans
l’Epître aux Romains : « L’homme est justifié par la foi indépendamment
des œuvres de
Malgré la
condamnation prononcée en juin 1520, Luther ne désarme pas. Il publie, entre ce
même mois de juin et celui de novembre, quatre ouvrages que l’on a pris
l’habitude d’appeler les grands écrits réformateurs. Interpellé, le 11 décembre
Luther répond en brûlant et les œuvres de Jean ECK, un de ses contradicteurs
les plus efficaces, un livre de Droit canonique et la bulle du pape. Le 3
janvier 1521, Luther est excommunié par la bulle Decet romamun. La rupture est
consommée.
Conclusion
Le 23 Fev 2007